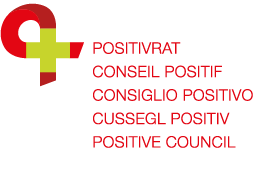Les soins de santé en prison : pourquoi cela nous concerne tous
La 13e conférence INHSU (International Network on Health and Hepatitis in Substance Users) qui s’est tenue récemment au Cap a montré que les prisons sont des lieux centraux, mais souvent négligés, dans la lutte contre le VIH et les hépatites virales B et C. 11,5 millions de personnes sont incarcérées dans le monde, et le risque d’infection y est particulièrement élevé.
Ainsi, 11,7 % des détenus dans le monde sont infectés par l’hépatite C (contre environ 1 % dans la population générale) et 3,7 % par le VIH (contre 0,7 % dans la population générale). Les femmes courent un risque deux fois plus élevé que les hommes.
Mais il y a de l’espoir : des solutions innovantes telles que les tests rapides sur place ou les autotests montrent leur efficacité. Dans les prisons australiennes, une campagne de dépistage a permis d’atteindre une couverture de 61 % et de réduire le taux d’hépatite C de 27 % à 15 % dans certains établissements. Dans le nord de l’Inde, un projet d’autotests a non seulement permis d’augmenter le nombre de diagnostics, mais aussi de traiter toutes les personnes atteintes d’hépatite C active. Malheureusement, ces tests ne sont pas encore autorisés en Suisse.
En Suisse, il existe de grandes différences entre les cantons et les prisons : certains offrent des soins médicaux complets, tandis que d’autres ne proposent même pas de dépistage de base des infections, de traitements de substitution aux opiacés ou de matériel préventif tel que des préservatifs ou des seringues stériles. Cela pose problème, car les prisons ne sont pas des espaces isolés, mais font partie intégrante de notre système de santé. Si les infections ne sont pas détectées ou traitées dans ces établissements, c’est une occasion manquée de soigner ces personnes, ce qui met en danger non seulement les personnes concernées, mais aussi les objectifs de santé publique.
Le programme national NAPS de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) reconnaît les personnes incarcérées comme un groupe clé nécessitant une attention particulière. De 2026 à 2030, leurs besoins en matière de santé dans le domaine des maladies infectieuses telles que le VIH et l’hépatite doivent être pris en compte de manière ciblée. C’est l’occasion d’uniformiser les soins de santé dans les prisons avec :
- le dépistage du VIH, de l’hépatite B et C pour toutes les personnes à leur entrée en détention
- l’accès aux traitements et aux mesures de prévention pour tous
Pourquoi est-ce important ?
- Justice : En Suisse, chaque personne a droit aux mêmes soins médicaux, qu’elle soit en liberté ou en détention.
- Prévention : dans les établissements fermés, tout le matériel de prévention doit être librement accessible afin d’éviter de nouvelles infections et de donner aux personnes la possibilité de se protéger.
- Atteindre les objectifs : ce n’est que si tout le monde a accès aux tests, aux traitements et à la prévention que nous pourrons atteindre les objectifs d’élimination en Suisse.
Les moyens et les connaissances sont là. Il s’agit maintenant de les mettre en œuvre dans tous les établissements pénitentiaires de Suisse.
Des questions ou des idées ? N’hésitez pas à nous écrire, nous nous réjouissons d’échanger avec vous !
Nathalie Brunner / novembre 2025
Autres sujets
EACS 2025 Paris: Nouvelles recommandations thérapeutiques
La Société européenne de lutte contre le VIH a tenu sa conférence en octobre à Paris. Cette conférence a lieu tous les deux ans. L’un des moments forts était, comme toujours, la dernière édition des recommandations thérapeutiques européennes et la
EACS 2025 Paris: La SHCS démontre sa force de recherche – trois études retenues par les présidents de la conférence
L’Étude suisse de cohorte VIH (SHCS) est représentée de manière prééminente dans toutes les conférences sur le VIH. Aucune autre étude de cohorte n’a plus de succès. Cela était particulièrement évident lors de la session « Co-Chairs Choice » –
SHCS: Différences de genre dans la prescription de statines chez les personnes vivant avec le VIH présentant un risque faible/moyen à élevé de maladies cardiovasculaires
Abela et al, Open Forum Infectious Diseases Grâce aux médicaments modernes, les personnes vivant avec le VIH ont aujourd’hui une espérance de vie similaire à celle des personnes ne vivant pas avec le VIH. Elles présentent néanmoins un risque plus