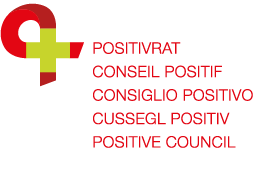Les femmes et le VIH – Entretien avec Anna Hachfeld
Anna Hachfeld est médecin généraliste et infectiologue au cabinet médical Zähringer-Ahornweg à Berne et chargée de cours à la faculté de médecine de l’université de Berne. Jusqu’en décembre 2024, elle a travaillé comme médecin-cheffe à la clinique d’infectiologie de l’Inselspital de Berne et comme directrice médicale au Checkpoint Berne. Elle dirige le groupe de travail WAVE Menopause de la Société clinique européenne du sida ( European Aids Clinical Society EACS ) et est membre du comité directeur de l’Aide Sida Berne. Ses recherches portent principalement sur le VIH et les femmes.
Claudia Langenegger : Anna Hachfeld, que sait-on des femmes séropositives en Suisse ?
Anna Hachfeld : Les données nous sont fournies par l’OFSP et l’étude de cohorte suisse (SHCS) : fin 2024, environ 17 600 personnes vivaient avec le VIH en Suisse, dont un quart sont des femmes, soit 4 400 femmes. Plus de la moitié d’entre elles ont plus de 50 ans et environ un tiers sont en transition ménopausique ou en périménopause.
Le traitement antirétroviral (TAR) est-il aussi efficace chez les femmes que chez les hommes ?
Oui, les médicaments contre le VIH disponibles chez nous sont également très efficaces chez les femmes. Cependant, pendant longtemps, les études d’autorisation n’ont pratiquement inclus que des hommes jeunes. La proportion de femmes et de personnes âgées est encore souvent faible aujourd’hui. Le dosage est toutefois le même pour les hommes et les femmes pour tous les médicaments.
Un dosage plus faible ne serait-il pas suffisant pour les femmes ? Elles sont en moyenne plus petites, plus légères et leurs hormones et leur métabolisme sont différents de ceux des hommes.
C’est une question très importante. Des études ont montré que les femmes ont des taux sanguins plus élevés de certaines substances et que certains effets secondaires sont plus fréquents chez elles. Cependant, lors du développement de nouveaux médicaments contre le VIH et de la détermination de la posologie, l’efficacité est la priorité absolue, à savoir la suppression de la charge virale. La question des effets secondaires ne vient qu’après. De même, les posologies individualisées, par exemple en fonction du sexe ou de l’âge, n’ont guère retenu l’attention ces dernières années.
Y a-t-il d’autres aspects spécifiques aux femmes dans le traitement du VIH ?
Pendant de nombreuses années, la plupart des traitements combinés contenaient le principe actif ténofovir disoproxil (TDF), qui peut être toxique pour les reins et augmente le risque d’ostéoporose. Les femmes sont plus touchées par ce phénomène, car avec la ménopause, la production d’œstrogènes diminue et la fonction protectrice de cette hormone disparaît : la densité osseuse diminue et le risque cardiovasculaire augmente. De nombreuses thérapies combinées plus récentes contiennent désormais le principe actif ténofovir alafénamide (TAF), une version améliorée du TDF. Une dose beaucoup plus faible est nécessaire pour obtenir la même efficacité. Les os et les reins sont moins endommagés. Cependant, le TAF peut augmenter le taux de cholestérol, entraîner une prise de poids et ainsi augmenter davantage le risque cardiovasculaire chez les femmes.
Les perspectives ne sont pas réjouissantes pour les femmes : pendant la ménopause, elles doivent souvent lutter contre des kilos indésirables en raison des changements hormonaux.
Que sait-on de la ménopause et des traitements antirétroviraux ?
Malheureusement, il existe encore trop peu d’études à ce sujet. Il n’est souvent pas facile de distinguer les symptômes : les troubles du sommeil, la prise de poids ou les problèmes digestifs peuvent être aussi bien des symptômes de la ménopause que des effets secondaires du traitement. Lorsqu’une femme d’une cinquantaine d’années souffre soudainement de sueurs nocturnes, de douleurs articulaires et de troubles digestifs, cela peut susciter des craintes – que l’infection par le VIH ne soit pas bien contrôlée ou qu’il s’agisse d’effets secondaires du médicament.
Chez les femmes, la grossesse, l’accouchement et l’allaitement sont également des sujets importants. Quelle est la situation actuelle en matière de risque de transmission, quelles sont les recommandations ?
Si la charge virale est supprimée pendant la grossesse et surtout au moment de l’accouchement, le risque de transmission est minime et les femmes peuvent accoucher par voie vaginale et allaiter. Le risque de transmission du VIH sous traitement est estimé à 0,3 % – ce chiffre suppose que la mère présente entre-temps des phases virémiques (phases pendant lesquelles les virus continuent de se propager dans le sang).
Les résidus de médicaments dans le lait maternel ne sont-ils pas nocifs pour les bébés ?
Les médicaments contre le VIH sont détectables dans le lait maternel. Cependant, leur concentration est faible. À ce jour, aucune étude n’a montré d’effet nocif pour les bébés allaités. En Afrique subsaharienne, il est depuis longtemps admis que les mères séropositives peuvent allaiter à condition de suivre un traitement antirétroviral. En effet, la mortalité infantile est plus élevée chez les nourrissons nourris au biberon, en raison de la contamination de l’eau potable et du manque de lait en poudre.
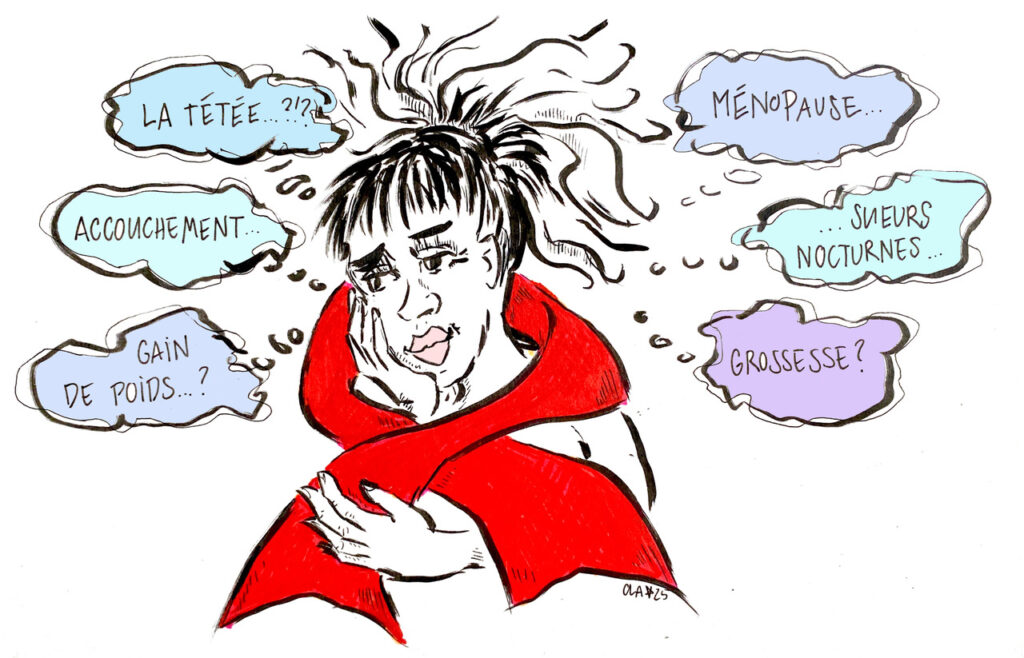
Image Claudia Langenegger
Que se passe-t-il si le virus n’est pas supprimé ?
Le risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant sans traitement, avec un accouchement par voie basse et l’allaitement, est compris entre 20 et 30 %. C’est pourquoi les mères dont le virus n’est pas supprimé au moment de l’accouchement subissent une césarienne. L’enfant reçoit des médicaments anti-VIH à titre de prophylaxie post-exposition et n’est pas allaité.
Que recommande la Suisse ?
La Suisse est le premier pays industrialisé à avoir recommandé l’accouchement par voie basse aux femmes séropositives dont la charge virale est durablement supprimée et à autoriser l’allaitement si les femmes le souhaitent. Jusqu’à présent, si une mère voulait allaiter, elle devait le cacher à son médecin et à ses sages-femmes. À l’inverse, dans la communauté africaine par exemple, la crainte d’une révélation involontaire est grande : celles qui n’allaitent pas sont considérées comme séropositives.
La grossesse et l’allaitement ne posent donc aucun problème pour les femmes séropositives.
Nous devons avant tout bien informer les femmes et leurs partenaires : jusqu’à récemment, beaucoup de femmes ne savaient pas qu’elles pouvaient avoir des enfants malgré le VIH et beaucoup ne savent toujours pas qu’il n’y a pratiquement aucun risque de transmission grâce au traitement. Je rencontre régulièrement des femmes qui n’ont pas pu réaliser leur désir d’enfant et qui, pour ces raisons, ont commencé très tard à planifier leur famille.
Quelles sont les recommandations dans les autres pays industrialisés ?
Actuellement, les choses bougent et d’autres pays industrialisés emboîtent le pas : l’allaitement doit également être rendu possible ici. Il est important de mettre le bien-être des femmes au centre des préoccupations : celles qui souhaitent allaiter doivent pouvoir le faire sans culpabilité ni crainte. Cela suppose toutefois que les femmes soient bien informées et bénéficient d’un suivi étroit et de qualité, car il ne doit en aucun cas y avoir de transmission du VIH à l’enfant.
Y a-t-il toujours des différences dans la prise de la PrEP pour les femmes et les hommes ?
Chez les femmes, il faut plus de temps pour atteindre le niveau protecteur du médicament dans la muqueuse vaginale. Elles doivent donc commencer à prendre le médicament sept jours avant le rapport sexuel et ne peuvent pas prendre la PrEP de manière intermittente (« à la demande ») comme les hommes.
Qu’est-ce qui a changé ces dernières années dans la recherche sur le VIH en ce qui concerne les femmes ?
Aujourd’hui, les femmes, y compris les femmes transgenres, sont également impliquées dans les études sur les médicaments, ce qui est désormais considéré comme un signe de qualité. Cependant, les femmes enceintes ou celles qui souhaitent le devenir sont toujours exclues et il faut encore beaucoup de temps avant d’obtenir des données sur la sécurité pendant la grossesse après l’introduction d’une nouvelle substance. L’étude Purpose, dans laquelle le lénacapavir a été testé comme médicament PrEP, est un exemple positif. Les femmes y étaient bien représentées et n’étaient pas exclues même en cas de grossesse. Il y a donc eu des progrès, mais il reste encore des améliorations à apporter.
Merci pour cet entretien.
Claudia Langenegger / août 2025
Données et faits
Source: étude sur la stigmatisation en Suisse
Les femmes, les hétérosexuels et les personnes de couleur sont les plus touchés par la stigmatisation et l’autostigmatisation :
- 91 % des femmes hétérosexuelles se soucient beaucoup de la confidentialité de leur statut sérologique
- 60 % ont peur d’être exclues si elles révèlent leur séropositivité
À la ménopause, les problèmes de santé sont fréquents chez les femmes séropositives :
- 27 % suivent un traitement psychiatrique ou souffrent de dépression
- 41 % sont en surpoids
- 8 % sont en sous-poids
- 45 % fument régulièrement
- 18 % ont une consommation d’alcool élevée
Liens complémentaires :
Etude Suisse de cohorte VIH – Swiss HIV Cohort Study (SHCS) :
https://www.shcs.ch
Etude femmes et ménopause 2022 : Women with HIV transitioning through menopause: Insights from the Swiss HIV Cohort Study (SHCS)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hiv.13255
Etude Stigma : Prevalence of HIV-related stigma among people with HIV in Switzerland: addressing the elephant in the room
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11424058/#abstract1
https://www.ejog.org/article/S0301-2115(23)00058-1/fulltext
Etude sur l’allaitement chez des mères VIH positives :
https://tghncollections.pubpub.org/pub/19-humanes-immundefizienzvirus-hiv/release/1
Autres sujets
EACS 2025 Paris: Nouvelles recommandations thérapeutiques
La Société européenne de lutte contre le VIH a tenu sa conférence en octobre à Paris. Cette conférence a lieu tous les deux ans. L’un des moments forts était, comme toujours, la dernière édition des recommandations thérapeutiques européennes et la
EACS 2025 Paris: La SHCS démontre sa force de recherche – trois études retenues par les présidents de la conférence
L’Étude suisse de cohorte VIH (SHCS) est représentée de manière prééminente dans toutes les conférences sur le VIH. Aucune autre étude de cohorte n’a plus de succès. Cela était particulièrement évident lors de la session « Co-Chairs Choice » –
SHCS: Différences de genre dans la prescription de statines chez les personnes vivant avec le VIH présentant un risque faible/moyen à élevé de maladies cardiovasculaires
Abela et al, Open Forum Infectious Diseases Grâce aux médicaments modernes, les personnes vivant avec le VIH ont aujourd’hui une espérance de vie similaire à celle des personnes ne vivant pas avec le VIH. Elles présentent néanmoins un risque plus