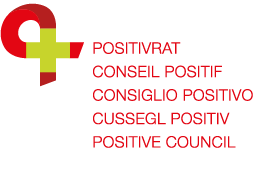40 ans d’interdiction de distribution de seringues à Zurich
Je voudrais raconter ici l’histoire de deux jeunes femmes qui ont été victimes de cet acte stupide et de l’attitude qui le sous-tend. Elles et toutes les autres victimes méritent que nous n’oublions jamais ce qui s’est passé il y a 40 ans à Zurich, à Bellevue, derrière la gare centrale, dans le quartier de Niederdorf.
J’ai eu mon premier contact avec l’hépatite et la drogue à l’âge de 11 ans grâce à mon oncle B. Il travaillait en 1970 comme jeune médecin au Drop-in de Zurich. Souvent, il nous parlait de son travail, à ma sœur et à moi. Le drop-in était un lieu où les personnes qui s’injectaient des substances pouvaient passer sans prendre rendez-vous en cas d’urgence. B. devait soigner de nombreux abcès, mais il parlait aussi de patients qui étaient jaunes parce qu’ils avaient une hépatite aiguë. A l’époque, nous, les enfants, trouvions cela drôle et faisions toutes sortes de blagues horribles à ce sujet. Mais j’avais ri trop tôt, car vers 1990, j’avais moi-même contracté l’hépatite C, probablement sur le Platzspitz à Zurich.

Le kiosque à musique sur la Platzspitz de la ville de Zurich aujourd’hui. (Image fournie)
Le comportement envers les personnes qui s’injectent des substances dans les années 1980
En 1985, l’opinion courante dans la société sur les personnes qui utilisent des substances n’était pas seulement négative, mais aussi dure et ignorante. La plupart des gens pensaient que la dépendance était une faiblesse de caractère qui ne pouvait être soignée que lorsque les personnes concernées touchaient le fond. Ce n’est qu’alors qu’elles seraient prêtes à corriger leurs mauvaises habitudes. C’est pourquoi il serait bon qu’ils tombent vraiment malades, peut-être qu’ils pourraient alors reconnaître la bonne voie et changer durablement pour le mieux. Mais on n’avait pas prévu que les personnes qui s’injectaient des substances avec des ustensiles non stériles contractaient des maladies incurables et mortelles, les transmettaient et les propageaient immédiatement dans la société à une échelle effrayante. Les connaissances sur le danger étaient certes disponibles, le virus de l’hépatite B a par exemple été découvert en 1967, mais il ne s’est que lentement infiltré dans la conscience des citoyens, et malheureusement aussi dans celle du corps médical. Même après la découverte du VIH, le médecin cantonal Kistler a maintenu l’interdiction de distribuer des seringues et a commenté : « Je reconnais que le sida se propage jusque dans les meilleurs cercles via la prostitution d’approvisionnement. Du point de vue de la médecine préventive, la remise de matériel d’injection propre n’est pas très utile, car les toxicomanes ont peu conscience de l’hygiène ».[2]
On pourrait argumenter que l’interdiction a été conçue pour décourager la consommation de drogues – peut-être en partant de la conviction que faciliter la consommation de drogues l’encouragerait. Aucune preuve n’a cependant jamais été apportée. L’interdiction de la distribution d’ustensiles d’injection stériles dans le canton de Zurich contrevenait à des principes éthiques importants – elle augmentait les dommages, sapait la dignité et donnait la priorité à la dissuasion morale sur la santé publique. L’interdiction n’était donc pas justifiable d’un point de vue éthique.
En octobre 1984, les personnes qui s’injectaient des substances représentaient 2 % du nombre total de cas de VIH déclarés en Europe. Un an plus tard, en octobre 1985, cette proportion était déjà de 8 %. En l’espace d’un an, cette proportion a augmenté de six points de pourcentage. Au milieu des années 80, la Suisse enregistrait le taux de fréquence le plus élevé d’Europe en matière d’infection par le VIH. [3]
L’histoire de K. et E.
Lorsque j’ai fait leur connaissance en 1980, K. et E. étaient deux jeunes femmes amies qui vivaient ensemble dans une colocation à Zurich Höngg. K. étudiait la médecine et E. était assistante médicale. Toutes deux aimaient la vie nocturne ainsi que la période très tumultueuse des troubles de la jeunesse des années 1980. Le soir, on pouvait généralement trouver K. et E. au bar Kontiki. Elles ne s’intéressaient pas beaucoup à la politique, elles voulaient simplement profiter de la vie au maximum. Cela incluait bien sûr la consommation de diverses substances. En fait, elles utilisaient tout ce qui était disponible à l’époque. K. avait développé une affinité pour la codéine dès son enfance, car son père était dentiste et avait toujours une grande bouteille dans l’armoire de la salle de bain. Bien des journées scolaires pénibles étaient plus faciles à supporter avec quelques gouttes amères dans le corps. Ainsi, K. n’avait aucune inhibition à essayer l’héroïne plus tard et à en consommer occasionnellement. Quand j’ai rencontré K., elle n’était pas encore dépendante d’une quelconque substance. C’était une jeune femme de 20 ans très enjouée, intelligente et pleine de vie.
J’ai vécu avec K. pendant environ trois ans, en partie dans la colocation avec E. à Höngg. Durant notre période commune, K. n’avait utilisé l’héroïne qu’occasionnellement. Je trouvais cela toujours terrible quand c’était le cas, car ses traits se transformaient alors de façon inquiétante et son expression se figeait. Ses yeux perdaient leur éclat et ses pupilles rétrécissaient à la taille d’une tête d’épingle. Cela me brisait toujours le cœur de voir K. ainsi. Une fois, j’ai eu une violente dispute relationnelle avec K. Suite à cela, K. a eu une telle crise de colère qu’elle s’est précipitée directement vers le rond-point de Bellevue. Là, elle a acheté une dose d’héroïne et l’a injectée avec la seringue usagée du dealer directement à l’arrêt du tram. J’étais totalement perplexe. Tout ce qu’elle avait appris sur l’hygiène était soudainement devenu complètement indifférent pour K. Il fallait que cela se passe rapidement et K. savait qu’à la pharmacie de Bellevue, elle n’obtiendrait certainement pas de seringue stérile.
Bien que K. ait entre-temps abandonné ses études de médecine et travaillait comme caissière dans un cinéma pornographique à Niederdorf, elle connaissait parfaitement les dangers associés aux seringues usagées. Mais même avant l’interdiction, il était pratiquement impossible d’obtenir un « fer » ou une « pompe »: argot suisse alémanique pour seringue) à Zurich. Je savais que si même mon amie K. échangeait sciemment des seringues, tous les autres le feraient aussi s’ils n’avaient pas d’autre choix. Le désir d’héroïne et de cocaïne était définitivement plus fort que la raison, donc les mesures éducatives du genre du Dr Kistler n’étaient pas efficaces.
Beaucoup de personnes infectées à l’époque sont mortes depuis, car dans les premières années après la découverte, il n’y avait pas encore de médicaments contre le VIH. Recevoir un tel diagnostic équivalait à une condamnation à mort. Moi-même j’ai dû attendre plusieurs fois longtemps pour des résultats de tests VIH, ce qui était toujours extrêmement désagréable et inquiétant, par exemple après un contact interpersonnel correspondant. Mais j’ai toujours eu de la chance et je n’ai jamais été infecté par le VIH. Lors d’une telle occasion, une autre amie a reçu un résultat de test positif. Nous étions bien sûr toutes les deux choquées, je m’attendais plutôt au résultat inverse. Notre relation s’est malheureusement rapidement détériorée. Nous étions toutes deux totalement dépassées par la situation. Comme ma propre histoire à l’époque n’était pas déterminée par l’héroïne mais par la consommation abusive de cocaïne, je n’ai été infecté que beaucoup plus tard et heureusement seulement par le virus de l’hépatite C, aujourd’hui facilement guérissable. Les ustensiles à l’époque étaient déjà stériles, mon hépatite C a probablement été transmis par l’eau sur une table à filtres. Comme le virus hépatite C est 10 fois plus contagieux que le VIH, le virus n’était pas tué même par ébullition dans une cuillère. Pour l’empêcher, il faut utiliser des cuillères à usage unique stériles, des filtres et des doses individuelles emballées de solution saline.
La vie de K. sous traitement de substitution et avec le VIH
K. avait bien survécu aux premières années sans médicaments contre le VIH. Pendant longtemps, elle a vécu à l’étranger, était clean et avait un excellent emploi sur une base de plongée en mer Rouge, où elle a également suivi une formation d’instructrice de plongée. De retour à Zurich dans son ancien environnement, K. a malheureusement rechuté. De plus, ses cellules T auxiliaires étaient devenues si peu nombreuses qu’elle a dû commencer l’une des premières thérapies contre le VIH (la première combinaison triple). À côté de la thérapie de substitution aux opioïdes, K. consommait occasionnellement de la cocaïne et, tragiquement, à la suite d’une telle consommation, elle a eu un attaque cérébrale dû à un effet secondaire/interaction connu avec les médicaments contre le VIH. La paralysie unilatérale et les troubles du langage, K. a pu les guérir en grande partie en relativement peu de temps grâce à un entraînement acharné, si bien qu’elle pouvait à nouveau marcher et n’avait plus besoin d’aide. Mais ce n’était que le début de son calvaire. J’étais au travail quand mon téléphone portable a sonné. Un ami de K. était au bout du fil : K. est dans le coma aux soins intensifs de l’USZ. J’y suis allé immédiatement. K. était allongée sur une table de traitement entourée de médecins, elle venait d’avoir une crise d’épilepsie suite à une nouvelle attaque cérébrale. Cette fois, K. a eu beaucoup de malchance, car son partenaire de l’époque, R., n’était pas à la maison. Après l’incident, elle était restée inconsciente sur le sol de la salle de bain pendant au moins 12 heures sans que personne ne s’en aperçoive. Une intervention rapide n’était donc plus possible. Cette fois, l’autre moitié du corps, jusqu’alors en bonne santé, était complètement paralysée. Par conséquent, après s’être réveillée du coma quelques jours plus tard, K. a eu besoin de soins à 100% pour le reste de sa vie. L’atteinte était motrice, mais mentalement, K. était toujours en forme. Au début, il a été très difficile de trouver le bon lieu de soins pour elle. Elle était encore trop jeune pour une maison de retraite et dépendante de la thérapie de substitution. À un endroit, K. a été si mal traitée qu’elle s’est retrouvée déshydratée aux urgences. Il s’est avéré que le gérant de l’établissement mélangeait du cannabis dans la nourriture pour calmer ses protégés la nuit. Pour qu’ils n’aient pas à aller trop souvent aux toilettes, ils recevaient simplement moins à boire. Finalement, on a trouvé une place pour elle au Lighthouse de Zurich, mais seulement après une terrible odyssée à travers différents établissements de soins.
K. a ensuite vécu plusieurs années au Lighthouse de Zurich, un hospice pour des personnes mourants, assez satisfaite compte tenu des circonstances. Ici, elle recevait des soins et une attention optimaux. La seule chose déprimante à propos de cet endroit était que les personnes sympathiques qui y étaient aussi mouraient constamment. Son partenaire de l’époque, R., rendait visite à K. tous les jours, il habitait tout près et s’occupait de K. avec dévouement. Il lui tenait les cigarettes à la bouche ou la grattait si nécessaire, la promenait dans son fauteuil roulant, préparait du café et réglait le programme de la télévision. R. avait lui-même le VIH, l’hépatite C et des lymphomes. Une nuit, R. est mort subitement chez lui, la cause du décès n’a pas pu être déterminée. Pour K., le monde s’est encore une fois effondré, c’était terrible, son désespoir était immense. La seule grâce que le virus VIH a accordée à K. était la possibilité de mettre fin à sa vie de manière autodéterminée. K. a convoqué ses amis restants et a expliqué qu’elle allait cesser immédiatement de prendre ses médicaments contre le VIH car elle ne voulait plus continuer à vivre. K. est morte paisiblement d’une pneumonie après quelques semaines.
E. et son infection à l’hépatite non traitable
Notre amie commune E. avait fui la Tchécoslovaquie avec ses parents en 1968 et avait fréquenté l’école en Suisse. Quand je l’ai rencontrée, elle travaillait comme assistante médicale dans un cabinet médical. Elle n’aimait pas vraiment ce travail. Elle préférait sortir avec K. dans la vie nocturne de la ville de Zurich. Quand l’occasion s’est présentée de travailler comme caissière dans un cinéma pornographique avec K., elle a saisi l’opportunité et a abandonné son emploi d’assistante médicale. Malheureusement, elle avait aussi une grande prédilection pour le « Sugar » (héroïne) et l’administration intraveineuse. Pas étonnant qu’elle ait été rapidement infectée par les virus de l’hépatite et du VIH. Quelques années plus tard, E. a ressenti les premiers effets. Elle souffrait d’une hépatite B chronique, se sentait constamment mal et était souvent fatiguée. E. ne pouvait donc bientôt plus travailler, a développé une cirrhose du foie et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises par la suite. Son pronostic s’est rapidement détérioré. Des médicaments comme le ténofovir n’existaient pas encore à l’époque. E. est morte avant K. aux soins intensifs des suites de son hépatite.
Qu’avons-nous appris de tout cela?
Le cas n’était pas toujours aussi clair que pour K. et E. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de la politique inhumaine de distribution de seringues sans cause de décès claire. L’Association médicale de Zurich a exclu le Dr Kistler de l’organisation professionnelle dans les années qui ont suivi, mais le médecin cantonal n’a jamais été licencié par le canton de Zurich. Faut-il exiger un traitement officiel et un commentaire sur les événements d’il y a 40 ans ? En fait, les autorités procèdent encore par endroits de manière similaire. Pensons seulement aux diverses prisons en Suisse où aucun matériel d’injection stérile n’est distribué, avec pour justification : Les drogues sont interdites dans cette prison !
Oliver Wehrli / Mai 2025
[1] https://www.beobachter.ch/gesundheit/medizin-krankheit/das-masken-desaster-302929
[2] https://www.tagesanzeiger.ch/_external/storytelling/platzspitz/kapitel2/index.html
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/Spritzentausch
Autres sujets
EACS 2025 Paris: Nouvelles recommandations thérapeutiques
La Société européenne de lutte contre le VIH a tenu sa conférence en octobre à Paris. Cette conférence a lieu tous les deux ans. L’un des moments forts était, comme toujours, la dernière édition des recommandations thérapeutiques européennes et la
EACS 2025 Paris: La SHCS démontre sa force de recherche – trois études retenues par les présidents de la conférence
L’Étude suisse de cohorte VIH (SHCS) est représentée de manière prééminente dans toutes les conférences sur le VIH. Aucune autre étude de cohorte n’a plus de succès. Cela était particulièrement évident lors de la session « Co-Chairs Choice » –
SHCS: Différences de genre dans la prescription de statines chez les personnes vivant avec le VIH présentant un risque faible/moyen à élevé de maladies cardiovasculaires
Abela et al, Open Forum Infectious Diseases Grâce aux médicaments modernes, les personnes vivant avec le VIH ont aujourd’hui une espérance de vie similaire à celle des personnes ne vivant pas avec le VIH. Elles présentent néanmoins un risque plus